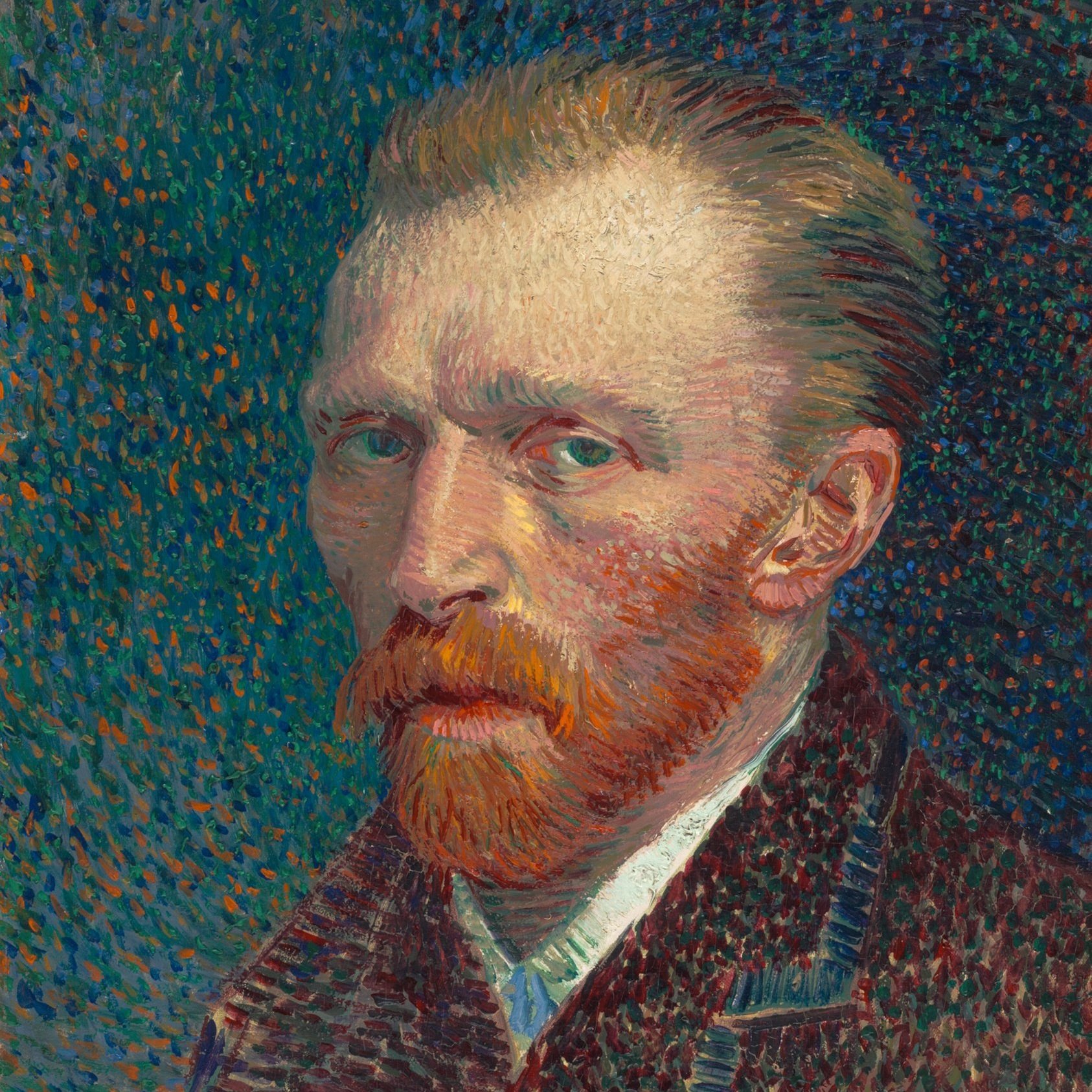De 1920 à 2020 : le swing, l'electro-swing et leurs évolutions
Fin 1928. Vous voilà dans le Chicago des gangs et de l’imaginaire. Vous entrez dans l’un des innombrables clubs illégaux de la Prohibition, lieux des vices et des nuits endiablées.
Sur la scène enfumée, entourée de petites tables où s’entassent les verres de contrebandes, jouent un orchestre légèrement différent de ce que vous auriez pu voir au début de la décennie : batterie, saxophone, trombone, trompette, piano, guitare et contrebasse, entre 12 et 16 musiciens ! Et, inimaginable dans d’autres endroits du pays, des blancs jouant avec des noirs dans cette composition d’un nouveau genre de jazz.
Vous assistez aux premiers accords d’un genre qui dominera bientôt la scène américaine.
Bienvenue dans l'ère du Swing !
Le swing, le phénomène musical et culturel des années 1930-1940
Le swing trouve son origine dans la popularisation du jazz à la fin des années 20. Lorsqu’il devient plus accepté pour les élites américaines d’écouter de la “musique noire”, ceux-ci l’introduisent dans les salles de bal. Mais le jazz, reposant par définition sur l’improvisation, se danse assez difficilement. D’où le besoin rapide de développer une branche nouvelle pour répondre à ces demandes grandissantes, mettant l’emphase sur l’écriture de la musique et son respect durant les représentations.
De plus, avec la Crise de 1929, l’industrie musicale s’effondre presque entièrement, et il devient difficile pour les artistes de vivre de leurs rares scènes. Nait ainsi la tendance au “big band”, un élargissement des groupes, jusqu’à parfois 20 artistes en même temps. En moyenne, un groupe de swing se composait de 3 trompettes, 2 trombones, 4 saxophones/clarinettes et d’une section rythmique (piano, guitare, contrebasse, batterie).
La naissance du swing marque le premier succès commercial à l’échelle mondiale (occidentale dans les faits) du jazz, en tant que branche anoblie (abâtardie pour certains).
Le mot même de “swing” est utilisé plus spécifiquement pour désigner une technique qui consiste à allonger et à raccourcir alternativement la première et la deuxième note consécutives dans les deux divisions du pulse dans un temps. Cette technique crée un effet de balancement ou de balancier, d’où le nom anglais de swing.
Un introduction à la technique du “swing”
La plupart des jazzistes que vous connaissez ont, à un moment ou à un autre de leur carrière, été des musiciens de swing. Si je vous dis Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, tous ont puisé dans ce genre répandu pour développer leur propre style.
Le swing comme danse
En tant que danse, le swing est à la fois un ensemble solo ou en couple. Il se caractérise par un élan rythmique, un rebond dans le sol, une touche d’improvisation et surtout un mouvement permanent de balancier lié aux mouvements même de la musique .
Le swing comprend plusieurs styles associés et inspirés, tels que le charleston, principalement solo et caractérisé par ses mouvements de jambes rapides et saccadés, sans oublier d’amples mouvements des bras.
Le lindy hop, danse de couple uniquement et qui se danse en mouvements circulaires permanents. Née dans les bars de Harlem au début des années 30, elle est rapidement devenue l’une des danses swings les plus populaires pour sa simplicité et son espace pour l’improvisation.
Le Balboa, une variante du Charleston, a été pensé pour que les danseurs prennent moins de place sur la piste. La base du balboa repose sur un pas glissé et tournoyant en trois temps (préparation, glissement, pose), plus lent que le lindy hop.
Le Shag est une danse mythique pour ses pas frénétiques, faisant penser à des claquettes, ses sauts et plus généralement son rythme saccadés. Les danseurs sont comme en constante lévitation, sautants et virevoltant sur toute l’étendue de la piste.
Vous verrez souvent, comme c’est le cas dans cette vidéo, les danseurs avec un grand sourire, presque obligatoire dans n’importe quelle représentation.
Le shag est le symbole, s’il en fallait, des derniers soubresauts des Années Folles.
Le Jitterbug décolle du lindy hop et se caractérise tout autant par son énergie. Plus encore acrobatique que cette dernière, sa figure emblématique est le “air step”, c’est-à-dire un saut couplé à une figure.
Enfin, le Boogie-Woogie se danse en 6 temps, ce qui est assez rare pour le souligner. Un pas sur place, deux pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur place à nouveau et ainsi de suite.
Le boogie-woogie est né de l’évolution du jitterbug et de certaines erreurs de danseurs, comme l’explique la vidéo d’archive plus haut. C’est pourquoi vous pourriez reconnaître quelques similarités.
Le Swing dominera la scène musicale américaine jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Durant celle-ci, (avec Stan Brenders en tête de file) les hommes étant pour la plupart mobilisés, on voit une démocratisation et surtout, une normalisation des musiciennes dans les big bands (avec le groupe Woody Hermans’ par exemple).
Après 1945 et durant la décennie suivante, le swing laissera petit à petit la place au genre bebop, avec ses groupes beaucoup plus restreints et qui préfigure l'apparition du rock ‘n ‘roll (les jump bands, accentuant encore davantage l’importance du chanteur / du soliste).
Mais l’histoire du Swing ne s'arrête pas là.
L’electro-swing, la renaissance moderne du swing
Dans les années 90, avec l’explosion du House et le développement de la musique électro, certains artistes décident de reprendre des enregistrements swing dans leurs compositions.
“Lucas with the Lid Off” de Lucas, en 1994, est considérée comme la première de ce nouveau genre, l’électro-swing, et en définit les lignes directrices de base : entre 120 et 140 BPM, une mélodie swing ou tout du moins des années 20 et l’utilisation de synthétiseur et de boîtes à rythmes.
Dans les Années 2010, le genre connaît un regain avec le hit mondial “We No Speak Americano” de Yolanda Be Cool & DCUP.
On peut aussi citer Parov Stelar et son “All Night”, là aussi pierre fondatrice du genre nouveau.
L’électro-swing est aussi répandu en France où est né l’un des principaux groupes contemporains du genre, Caravan Palace, mélangeant swing et disco avec de la house moderne.
Le développement de l’électro-swing remet aussi au goût du jour la danse swing, adaptée aux nouveaux rythmes plus rapides, et à une mode vestimentaire qui reprend des éléments typiques des années 20. C’est ce que l’on retrouve dans la plupart des clips vidéos du genre, comme celle-ci. Le mélange de ces styles anciens et modernes a ainsi pu faire parler certains d’un genre “Gatsby le Magnifique”, histoire placée dans les années 20 et dont la dernière version est peuplée de musiques proches de l’électro-swing.
La popularité installée de l’électro-swing s’est même développée au-delà de sa matrice d’origine : ainsi, on peut aujourd’hui retrouver des reprises électro de musiques des années 90, où l’artiste applique un “effet phonographe 1920”. Par exemple, beaucoup de musiques Disney ont le droit à leur version électro-swing, comme cette reprise de “A man like you” tirée du Livre de la Jungle, ou bien encore Aladdin. Mais peut-on encore parler de swing dans ces conditions ? Est-ce que la vision actuelle de l’électro-swing n’est pas simplement le mélange d’une musique pré-electro avec les codes actuels ? Quel nom donner à cette réalité musicale ?
Enfin, ces dernières années ont vu l'apparition de nouveaux sous-genres de l’électro-swing.
L’un des plus prometteurs et en rapide développement à l’heure actuelle est sans doute le Future Swing, porté en particulier par le DJ Bpop. Il se caractérise par des reprises de musiques certes anciennes, mais recomposées et chantées par des artistes contemporains (et non pas de simples remixages d’enregistrements d’époque), couplées à de puissantes basses proches de ce qui se fait dans le hip-hop / rap. En découle un style très moderne et prenant; bien que par nature moins dansant.
En résumé, et comme dans tous les arts contemporains, nous assistons à une résurgence certaine des modes et des genres anciens. Ici, c’est la musique du siècle dernier qui se réadapte aux goûts contemporains, las des films dont on fait une pléthore de suites et de prequels (souvent non nécessaires).
Faut-il y voir la simple nature cyclique des goûts ? Ou bien un besoin de regarder vers un passé fantasmé en contraste avec une image (martelée partout et à mon avis à tort) d’un futur qui sera invariablement immonde et sans espoir ?
Sans doute un peu des deux.
Nicolas Graingeot